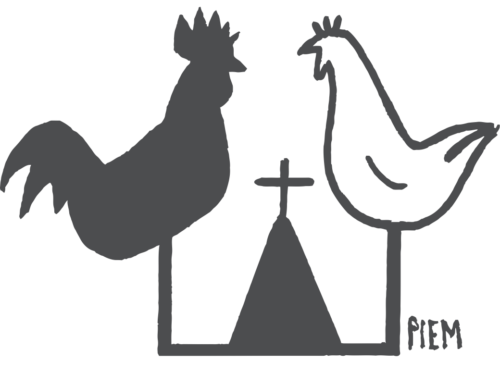Réflexion de Pierre Pierrard, historien chrétien, sur le célibat des prêtres, en suivant le cours de l’histoire.
Des origines au concile de Trente (XVIème siècle)
Il semble que, dès le 5ème siècle, l’Eglise romaine ait pris l’habitude de refuser l’ordination aux hommes qui s’étaient remariés après la mort de leur première femme ; si, au moment de leur élection aux ordres, ils n’étaient pas mariés, ils ne pouvaient pas le faire ensuite ; quant aux clercs mariés, ils étaient fortement invités à vivre dans la continence avec leur épouse.
Le lien établi – d’une manière qui est loin d’être universelle entre le sacerdoce et le non-usage de la sexualité, notamment dans le mariage, tient à plusieurs raisons, qui s’entremêlent : l’assimilation du prêtre au religieux, lequel est tenu à la continence dans le célibat, une assimilation qui fera problème durant des siècles, rejetée qu’elle sera par les clercs séculiers; la vieille opposition, reprise de saint Paul, mais aussi du stoïcisme et du néoplatonisme (qui soulignait le dualisme entre le corps et l’âme), entre la chair et l’esprit, tout acte sexuel étant assimilé aux « œuvres de chair », mauvaises en soi. Toute une théologie se développera autour de ce thème: Origène, par exemple, considérait que, la chair étant impure, la sexualité l’est aussi et que le péché se transmet, tel un poison, par l’acte sexuel.
On pourrait croire que, durant les siècles qui vont suivre, cette théologie va entrer dans les mœurs chrétiennes, et plus précisément dans les mœurs ecclésiastiques. Il s’en faut de beaucoup, et cela pour plusieurs raisons. D’abord, parce que la notion de mariage consacré met des siècles à se définir, si bien que le « concubinage », qui sera le fait d’innombrables clercs, sera considéré par les populations comme un mariage de fait, qui n’a rien en soi de scandaleux. Ensuite, parce qu’il fut longtemps difficile de distinguer les « clercs majeurs » des « clercs mineurs », ceux-ci pouvant être des laïcs mariés. Enfin, et surtout, parce que, jusqu’au concile de Trente, existe un large fossé entre ce qu’on pourrait appeler » la haute Eglise » – évêques et moines -, qui monopolise le pouvoir et la culture, et le « bas clergé », dit séculier (du siècle), sans formation, sans orientation, et assimilé au petit peuple dont il partage la vie. Dans de telles conditions, parler de « la décadence de la cléricature » à travers le long Moyen-âge relève de l’anachronisme.
Il est certain qu’au XIème siècle, quand la société occidentale commence à émerger de la féodalité, la plupart des prêtres vivent en « concubinage » ; leur compagne est parfois appelée prêtresse, ce qui suscite l’ironie des fabliaux mais non le scandale des fidèles (1). C’est l’époque de la Réforme grégorienne – de Grégoire VII et de ses successeurs -, au cours de laquelle les conciles locaux et les conciles romains (les 1er et 2ème conciles de Latran, 1123, 1139) multiplient les condamnations du « concubinage » ecclésiastique et plus encore du sacerdoce héréditaire ; les fils de prêtres ne pourront désormais être ordonnés sans une dispense de Rome : en aucun cas. ils ne pourront recevoir de bénéfice ecclésiastique ni succéder à leur père.
Du côté du clergé, les réticences se manifestent. En 1080, est rédigé en Normandie un traité intitulé « S’il est permis au prêtre de contracter mariage » : son auteur reproche à Rome d’imposer abusivement aux clercs séculiers des obligations qui n’incombent qu’aux moines. Dans l’Alsace du XIIème siècle, s’il faut en croire un chroniqueur contemporain, bon nombre de curés vivaient maritalement sans que cela choquât leurs paroissiens, qui s’en félicitaient plutôt, n’hésitant pas à dire qu’ainsi leurs femmes et leurs filles risquaient moins d’être importunées par le prêtre.
Aux XIVème et XVème siècles, au début de la Renaissance, la mise en cause du célibat des clercs prend une allure intellectuelle, au nom de l’humanisme, un humanisme qui, dans le temps, s’insurge contre la corruption des mœurs au niveau de la Haute Eglise, à commencer par les palais romains.
Ce que l’Humanisme reproche aussi à l’Eglise, c’est son discours sur la femme, un être méprisé, voire haï parce que trompeur irrécupérable, maléfique. Dans l’acharnement que l’Eglise mettra à exiger de ses clercs le célibat entre un très fort sentiment – ancestral – d’antiféminisme dont Jean Delumeau, dans La peur en Occident, XIVème- XVIIIème siècles (Fayard, 1978), a brillamment rendu compte, mille exemples à l’appui.
Du concile de Trente au XXème siècle
En ce qui concerne le célibat ecclésiastique, la Réforme protestante et la Réforme catholique prennent des orientations diamétralement opposées. Tandis que pour Luther, qui considère que le « sacrement de l’ordre a été inventé par l’Eglise du pape », le célibat est une offense à la fois au Dieu biblique et à la nature humaine, le concile de Trente (1545-1563) renforce les privilèges spirituels de la cléricature, la transformant en une caste supérieure, proche de Dieu et de sa perfection, et, par conséquent, pure de cœur et de corps.
En France notamment, il faudra un siècle pour que cette réforme du ministère sacerdotal entre dans la réalité quotidienne. Durant toute la première moitié du XVIIème siècle, tenue, mœurs, comportement, instruction, capacité, souci pastoral…, les visites des évêques et des prédicateurs révèlent sur tous ces points de graves déficiences chez de nombreux prêtres. Qu’on se souvienne des impressions de Vincent de Paul, missionnaire dans le Beauvaisis vers 1620 et découvrant la foule des « mauvais prêtres ». En 1638, visitant son diocèse, Alain de Solminihac, évêque de Cahors, constate que, dans maintes paroisses, « on ne fait nulle difficulté de mettre dans les livres des baptisés après le nom des enfants illégitimes, celui de leur père avec expression de sa qualité de prêtre comme s’il eût fallu laisser à la postérité des marques de leur incontinence « . Quarante ans plus tard, Étienne Le Camus, évêque de Grenoble, reçoit la démission de nombreux curés « vieux concubinaires » qui craignent son courroux.
Car, avec la fondation et la multiplication – à partir de 1660 – des séminaires, qui sont pris en charge, notamment, par les Sulpiciens, les Lazaristes et les Eudistes, la réforme ecclésiastique entre vraiment dans les faits et dans les mœurs. Ceci grâce à l’action et au rayonnement des grands mystiques appartenant à ce que qu’on a appelé « l’École française de spiritualité » : Bourdoise, Bérulle, Olier, Vincent de Paul, Jean Eudes… Eux font du prêtre séculier non seulement le « religieux de Dieu » mais l’homme qui, dans sa vie, doit rassembler toutes les vertus du religieux, et d’abord une chasteté absolue – devenue la « sainte Vertu » – dont le célibat est le signe intangible.
Désormais, alors que les cardinaux et les évêques exposent au grand jour des mœurs aristocratiques tout naturellement légères, la vie privée du prêtre séculier, essentiellement du prêtre de paroisse, entre dans une zone secrète, dont il ne sortira pas de sitôt.
Quand Alexis de Tocqueville, dans L’Ancien Régime et la Révolution (1856), note à propos du clergé français du XVIIIème siècle, qu’il y a eu rarement dans l’histoire un clergé « plus éclairé, plus national, mieux pourvu de vertus publiques et en même temps de plus de foi… », il a raison en gros, ou en surface. Car, si désormais la question du célibat ecclésiastique est considérée comme définitivement réglée par l’Eglise romaine, tout ce qui touche à la vie sexuelle et affective du prêtre est soigneusement tu.
Ce qui a pour effet de déchaîner l’anticléricalisme des tenants des Lumières, aux yeux de qui le célibat religieux obligatoire, imposé, est à la fois une hypocrisie, une forme de despotisme, une atteinte à l’autonomie de l’homme, un acte contre nature, une menace pour l’équilibre démographique de la Nation. En 1789, on évalue à 122 000 les hommes qui sont réputés ecclésiastiques. A l’article « clerc » du Dictionnaire philosophique de Voltaire, on trouve cette notation typique, qui résume tout : « Depuis le concile de Trente, il n’y a plus de dispute sur le célibat des clercs, il n’y a plus que des désirs ». Il est vrai que, dans sa prédication, l’Eglise du XVIIIème siècle ne cesse de condamner ces désirs, pensant ainsi les étouffer. Dans un cantique du plus célèbre missionnaire d’alors, Grignion de Montfort (1673-1716), les Vierges sages se gaussent en ces termes des Vierges folles, qui veulent se marier : « Que perd-on au mariage ? / Dirai-je la vérité ? / On se met en esclavage /. On perd en tranquillité. / On se souille, on s’embrasse /. Souvent on y perd la grâce. »
Tout naturellement, la Révolution jacobine (1792-1795) préconise et favorise le mariage des prêtres. Pour des motifs très divers, un nombre important de prêtres se marient alors : après le Concordat, leur situation canonique sera apurée par le cardinal Caprara. Par décret de 1806, Napoléon 1er « abandonne à leur conscience » – en fait autorise à se marier – les prêtres qui n’ont pas repris leur fonction depuis le Concordat de 1801.
Puis, la porte se referme : après 1806, le mariage, même civil, sera interdit aux prêtres, mesure qui, tout au long du XIXème siècle, va jeter à la rue, et parfois dans la misère noire, ceux qui voudront quitter leur état. Car Napoléon est un farouche partisan (pour les autres) du célibat qui, selon lui, crée une ascèse utile à l’État et à la
Nation. C’est pourquoi, il songe un moment à obliger au célibat les membres de l’Université impériale ; les congréganistes, frères ou sœurs, seront toujours préférés par lui aux instituteurs mariés : la Restauration, la Monarchie de juillet, la seconde République, le second Empire pratiqueront la même politique.
Au lendemain du Concordat de 1801, l’Eglise de France se reconstitue telle qu’elle était avant la Tourmente. Ernest Renan, parlant du séminaire de Saint-Sulpice, où il fut de 1842 à 1845, écrit : « Tout fut rétabli comme avant la Révolution ; chaque porte tourna dans ses anciens gonds, et comme d’Olier à la Révolution rien n’avait subi de changement, le XVIIème siècle eut un point de Paris où il continua sans la moindre modification. » Ceci était encore vrai en 1930.
Dans ces conditions, le prêtre, devenu fonctionnaire du culte, est, plus que jamais, astreint non seulement au célibat (il ne peut le rompre sans provoquer scandale et trouble), mais à la continence la plus parfaite. Qu’on ne vienne pas dire que cela réclame un héroïsme surhumain : « Une goutte d’huile sainte fait un prêtre chaste », réplique Lacordaire, qui sera cependant un familier des flagellations destinées à faire taire « le vieil homme ».
Et tandis que les innombrables auteurs de livres pieux – tel Henri Dubois, auteur de Le saint prêtre (1856) – multiplient les conseils de prudence aux curés et aux vicaires, qui sont nécessairement amenés à fréquenter femmes et jeunes filles, se déploie une formidable littérature anticléricale, axée principalement sur les débauches secrètes des prêtres : Le confesseur de ma femme d’Edgar Richer (1874) connaît, par exemple, un succès énorme. Tandis que, dans les séminaires, les Diaconales, écrites en un latin à la fois précis et prudent, initient les futurs confesseurs à une casuistique qui ne laisse dans l’ombre aucune des particularités des relations sexuelles humaines.
Or, le XIXème siècle, et encore le XXème siècle dans sa première moitié, renchérissent sur les siècles étudiés par Jean Delumeau dans la condamnation du sexe, et particulièrement du sexe de la femme : à tel point que, dans le langage ecclésiastique, la femme est désignée du nom de « personne du sexe… ». Ce qui n’empêche pas l’homme voué au célibat, ou tout simplement à une vie vertueuse, de se méfier de son propre sexe : tous ceux qui, dans leur enfance et leur adolescence, ont été élevés sur les bancs des petits séminaires, de juvénats ou de collèges religieux, ont souvenance de la place énorme, disproportionnée, envahissante qu’occupaient la sexualité et par opposition « la sainte vertu », dans leur existence et leurs fantasmes. Notre directeur répétait : » On parle quelquefois de la pureté, toujours des moyens de la conserver, jamais de l’impureté ». Bref : le grand écart à perpétuité.
Pour revenir au prêtre, et particulièrement au prêtre concordataire, si on ne sait rien ou presque, de sa vie privée – à moins que celle-ci ne soit dénoncée par la voix ou la méchanceté publiques -, on peut deviner, à travers des papiers oubliés dans les presbytères ou en lisant des ouvrages comme Les confessions d’un curé de campagne, d’Emmanuel Domenech ( 1883), ou Les mémoires d’un vicaire de campagne, d’Antoine Aumétayer ( 1843), ce que dut être la solitude de corps, d’esprit et de cœur de beaucoup de prêtres – les jeunes surtout – à une époque où, à peu de choses près, les 36 000 clochers de France étaient pourvus en curés (en 1869, on comptait, dans une France de 35 millions d’habitants, 56 295 prêtres). A la tête de paroisses de 200 âmes ou moins, certains (beaucoup ?) perdaient pied : ils recouraient à des occupations, à des compensations « convenables » – travail manuel, recherches historiques… – ou moins bien reçues, notamment la boisson. Sans oublier la femme, la servante ou autre : la compensation physique, ou tout simplement la recherche d’une affection, d’un être capable de partager, de dialoguer.
Cela peut conduire au crime, comme celui de l’abbé Mingrat, curé près de Grenoble, sous la Restauration, qui tua et dépeça la jeune femme qui attendait un enfant de lui (comme le fera, en 1956, le curé d’Uruffe, en Lorraine). Plus généralement, cela aboutit au déplacement, à l’exil dans quelque « Sibérie » du diocèse, sur ordre de Monseigneur. Mais cela peut aussi conduire au suicide : quand le père Blot, en 1891, fonde à Paris (15ème), une chapelle où l’on priera à l’intention des personnes poussées au désespoir et au suicide, il réserve une place dans ses prières aux prêtres suicidés. En 1968 encore, Jacques Duquesne ouvrira son livre Demain, une Eglise sans prêtres ? par un chapitre intitulé : » Monsieur le curé s’est suicidé » .
L’époque contemporaine
La Séparation des Eglises et de l’Etat (1905), si elle appauvrit matériellement l’Eglise de France, la libère spirituellement. Ce qui ne change rien à la discipline ecclésiastique, au contraire, l’autorité de Rome, de Pie X, se faisant plus pesante. La Grande Guerre, en mobilisant des milliers de séminaristes, de prêtres et de religieux, qui sont mêlés à la grande souffrance commune, provoque un rapprochement évident entre la masse indifférente ou ignorante et le clergé ; elle provoque aussi quelques « départs ». Mais, des « ex », des « défroqués », on ne parle pas : on les pousse vers la porte de service, qui donne sur le désert. Dans le monde ecclésiastique, et dans le monde tout court, on « ferme les yeux » sur les petites « fredaines » de certains, à partir du moment où elles sont cachées. J’ai reçu autrefois les confidences de l’ancien secrétaire d’un dominicain célèbre vers 1920, lequel lui avait avoué : « Je ne puis me passer de femme » ; en effet, ce religieux avait deux enfants, parfaitement clandestins ; il devait mourir entouré d’honneurs, ayant vécu jusqu’au bout le modus vivendi que l’Eglise avait aménagé pour lui.
Dans l’histoire du prêtre français, l’entre-deux-guerres constitue une période d’euphorie. D’une part, on voit apparaître un nouveau type de prêtre : le prêtre ouvrier, l’aumônier de scouts, de la Croisade eucharistique, surtout l’aumônier de l’Action catholique spécialisée – la JOC notamment – qui est comme transfiguré par un apostolat inédit, à base de confiance et d’enthousiasme (« Nous referons chrétiens nos frères »). Un aumônier jociste écrit : « Il me semble que le célibat du prêtre, en JOC, est comme un lieu d’accueil, de rencontre de toute l’œuvre de l’Esprit Saint. Ça vaut le coup d’être tout entier donné, ordonné, pour vivre, accueillir les richesses des gars ». D’autre part, en vue de gonfler le recrutement sacerdotal, l’accent est mis, comme au XVIIème siècle, sur la prééminence absolue du prêtre : » II est au-dessus, bien au-dessus des simples fidèles » , écrit en I936, le R.P. Périnelle, OP, et aussi sur la place éminente de la mère de prêtre, comme en témoignent des ouvrages tels que mon petit prêtre ( 1917) du père Lhande ou Rêve de maman du chanoine Chauvin : il y a là un véritable « déplacement » d’ordre affectif.
Vient la Seconde Guerre mondiale, qui ouvre à tant de prêtres des horizons inconnus et les oriente vers la « Mission », elle aussi grosse de tous les espoirs et de tous les enthousiasmes. Vient ensuite le concile Vatican II (1962-1965), dont certains se demandent s’il n’a pas renversé le courant dans la direction de Luther et de Calvin, ces tenants du sacerdoce universel des baptisés ; dont d’autres pensent que, malgré le décret De Presbyterorum ministerio et vita, il a laissé le prêtre sur l’impression de n’avoir pas été pleinement compris, « d’être dans une position assez inconfortable entre l’évêque, dont on a souligné toute l’importance, et le laïc, rétabli dans la plénitude de sa vocation chrétienne » (Paul Guilmot).
Surtout : le prêtre se rend compte que le Concile n’a pas abordé, et a encore moins résolu, les problèmes vitaux de son existence – le célibat, notamment, que Paul VI s’est réservé -, et évité le fameux « malaise » du clergé, particulièrement sensible en France. Au début, on parle assez volontiers de « l’heure du prêtre », avec la mise en place des conseils presbytéraux, de la formation permanente… Mais on devine que la tempête menace : le prêtre, dans une société où, paradoxalement, les hommes sont à la fois de plus en plus solidaires et de plus en plus solitaires, se révèle écartelé. Comment être à la fois présent au monde et séparé ? Pasteur mais missionnaire ? Intermédiaire mais semblable ?… On le considère comme un être hybride dont on reste éloigné mais dont on ne tolère aucune faiblesse, un homme du passé, incapable de se dépêtrer de liens archaïques, ou, au contraire, comme un explorateur aveugle et sans boussole. Et comment concilier le célibat obligatoire avec la mystique du mariage qui se développe alors, en même temps que la réhabilitation de tout « le peuple de Dieu » ?
Et c’est la grande bourrasque des années 1965-1975, marquée par la chute, de plus en plus forte, des ordinations et des entrées dans les séminaires ; marquée, surtout, par le départ massif – plusieurs milliers – de prêtres désarçonnés, désemparés, ou scandalisés par l’inadéquation entre les promesses du printemps conciliaire et l’inertie institutionnelle.
————————–
(1) « Malgré la dureté de l’église, il semble que la plupart des clercs aient été encore mariés autour de l’an 1000. Cf. « Des eunuques pour le royaume des cieux, l’église catholique et la sexualité. Uta Ranke-Heinemann. Ed. Robert laffont. p. 124
Quelques notations personnelles
Ces « départs », comme ceux qui ont suivi, et qui ont toujours lieu, sont éminemment révélateurs ; ils devraient provoquer l’Eglise à recourir à la vertu majeure qu’est la vertu de discernement. Or, depuis que Paul VI s’est « réservé » la question du célibat ecclésiastique, celle-ci n’a cessé d’être reprise par des groupes de chrétiens nombreux et lucides, avec ses deux aspects principaux : la non-obligation du célibat pour accéder aux ministères consacrés ; la prise en compte, par l’Eglise, de l’existence de milliers de prêtres mariés et du capital spirituel et pastoral volontairement non employé qu’ils représentent, en compagnie de leurs épouses et de leurs enfants.
II ne suffit plus, comme on Ie faisait dans les presbytères et les sacristies d’autrefois, de déclarer, avec un clin d’œil, à l’annonce du » départ » d’un prêtre : « Cherchez la femme ». C’était une facilité, qui occultait les multiples problèmes nés du célibat obligatoire dans la cléricature ; c’était les réduire au seul domaine affectif, sexuel, un domaine où les gens d’Eglise ont toujours été d’une grande maladresse : comme si le détachement d’avec l’Institution ne pouvait pas ne pas être provoqué par des désillusions ou des souffrances existentielles.
Il est évident que beaucoup de prêtres ont trouvé ou trouvent dans la disponibilité offerte par le célibat un espace libérateur, propice à la fécondité et au bonheur. Il est non moins évident que, pour d’autres, que nous aimons, le célibat est un fardeau insupportable, qu’ils essaient d’alléger ou dont ils s’efforcent de se débarrasser en se tournant vers cet être de douceur et d’attention qu’est la femme, compagne naturelle de l’homme.
Alors on dit : le prêtre est incapable de fonder un foyer, un ménage solide. Voilà encore une de ces pétitions de principe par lesquelles on s’évade du monde réel ! Les richesses intellectuelles et spirituelles apportées par un prêtre sont immenses : alliées à celles d’une épouse, elles peuvent composer un type humain, un couple d’une teneur exceptionnelle.
Bien sûr, le prêtre, en se mariant, n’est pas déchargé de ses habitudes, de ses schémas de pensée, de ses réactions de célibataire, ou plutôt de vieux garçon. C’est précisément sur le plan du « vieux-garçonnisme » que porte ma réflexion personnelle sur le célibat des prêtres. Je l’écris comme je le pense : ce qui me frappe chez beaucoup de prêtres, ce qui, souvent, me fait les distinguer parmi les hommes, c’est une certaine manière de se replier rapidement dans leur domaine personnel, de ne pas écouter vraiment ou de s’écouter parler, de laisser la méfiance ou l’ennui établir des distances, à la fois invisibles et palpables entre eux et leurs interlocuteurs. Bref, ce qui, à mes yeux, condamne le célibat obligatoire, c’est qu’il tend à fabriquer des introvertis.
Ce n’est pas que le mariage constitue le moule de la perfection dans les rapports humains, surtout en ces temps où lui-même se délite. Mais il me semble que, pour un certain nombre de prêtres, peut-être pour un grand nombre, la présence constante d’une femme, être essentiellement accueillant et donnant, les aiderait à sortir d’eux-mêmes et à découvrir vraiment leur prochain.
Pierre Pierrard